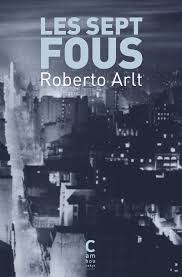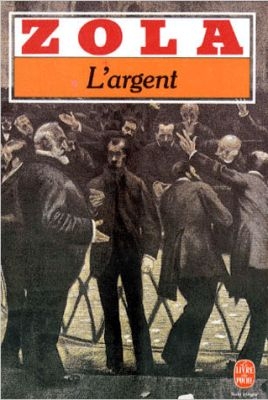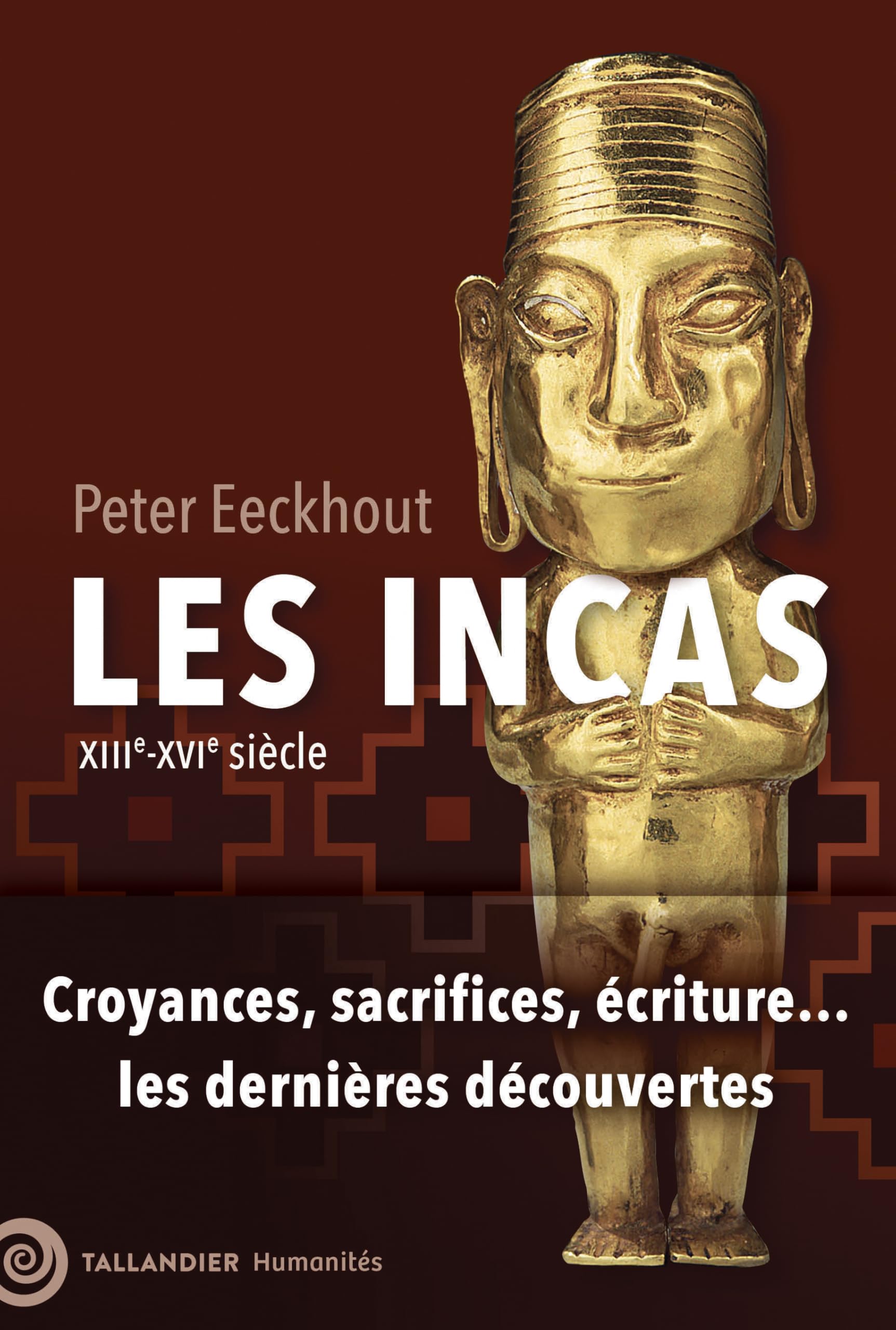Roberto Arlt, Les sept fous, Paris : éditions Cambourakis, 2019, 391 p. (édition originale : 1929) – Maintenant, quand je suis arrivé à la conclusion que Morgan, Rockefeller ou Ford étaient, grâce au pouvoir que l’argent leur conférait, quelque chose comme des dieux, je me suis rendu compte que la révolution sociale serait impossible sur terre, parce qu’un Rockefeller ou un Morgan pouvait détruire une race d’un seul geste, comme vous un nid de fourmis dans votre jardin.– A condition qu’ils aient le courage de le faire.– Le courage ? Je me suis demandé s’il était possible qu’un dieu renonce à ses pouvoirs… Je me suis demandé si un roi du cuivre ou du pétrole arriverait à se laisser dépouiller de ses flottes, de ses montagnes, de son or et de ses puits, et je me suis rendu compte que pour se priver de ce monde fabuleux il fallait avoir la spiritualité d’un Bouddha ou d’un Christ… et que eux, les dieux qui disposaient de toutes les forces, ne se laisseraient jamais évincer. Par conséquent, il devait se produire un événement énorme. (p. 197) Voilà ce qu’il y a de grandiose dans la théorie de l’Astrologue : les hommes ne…
Émile Zola L’argent, Paris : Librairie générale française, 1985, 543 p. (édition originale publiée en 1891) Comprenez donc que la spéculation, le jeu est le rouage central, le coeur même, dans une vaste affaire comme la nôtre. Oui ! il appelle le sang, il le prend partout par petits ruisseaux, l’amasse, le renvoie en fleuves dans tous les sens, établit une énorme circulation d’argent, qui est la vie même des grandes affaires. Sans lui, les grands mouvements de capitaux, les grands travaux civilisateurs qui en résultent, sont radicalement impossibles… C’est comme pour les sociétés anonymes, a-t-on assez crié contre elles, a-t-on assez répété qu’elles étaient des tripots et des coupe-gorge ! La vérité est que, sans elles, nous n’aurions ni les chemins de fer, ni aucune des énormes entreprises modernes, qui ont renouvelé le monde; car pas une fortune n’aurait suffi à les mener à bien, de même que pas un individu, ni même un groupe d’individus, n’aurait voulu en courir les risques. Les risques, tout est là, et la grandeur du but aussi. Il faut un projet vaste, dont l’ampleur saisisse l’imagination; il faut l’espoir d’un gain considérable, d’un coup de loterie qui décuple la mise de fonds, quand…
Peter Eeckhout, Les Incas : XIIIe-XVIe siècle, Paris : Tallandier, 2024, 526 p. L’auteur propose une synthèse des dernières découvertes et des relectures de l’histoire de l’empire inca permises par l’archéologie et les récentes avancées scientifiques (paléoclimatologie, études ADN, etc.). L’histoire de l’Empire inca a longtemps été tributaire des récits et des textes des colonisateurs européens. L’archéologie permet de vérifier ou d’infirmer ces récits et de remettre en cause la version standard, notamment de la chronologie impériale. A son apogée, l’Empire inca s’étendait sur près d’un million de kilomètres carrés, dans 4 grandes régions du sous-continent sud-américain : les Andes du Nord (Colombie), les Andes centrales (Pérou, Bolivie, Équateur), les Andes du Sud (Chili, Argentine) et les basses terres de l’Amazonie (Pérou, Bolivie). L’Empire a compté de neuf à dix millions de sujets, et rassemblait plus d’une centaine de peuples placés sous la domination des Incas. L’ontologie inca voyait les Incas comme vivant sur la Terre du milieu, entre le Ciel peuplé de divinités et le monde souterrain habité par les ancêtres. Rôles genrés : les genres masculin et féminin étaient perçus comme complémentaires et symétriques, selon un modèle de parallélisme des genres : les femmes sont descendantes d’une lignée…
Philippe Jaenada La désinvolture est une bien belle chose, Paris : Mialet-Barrault, 2024, 487 p. Avant de rejoindre la voiture, je descends vers la plage, je reste quelques instants sur la promenade. C’est la dernière fois, jusqu’à la fin de mon tour, que je vois l’eau, que j’entends le clapotis des vagues – qui m’accompagne tous les jours depuis le départ (sauf à Bagnères-de-Luchon – où je n’ai même pas fait de cure d’eau, car je suis en pleine forme). Ça ne me fera pas de mal, j’ai besoin de changer, j’ai envie de remonter vers le nord. Je me rends compte que je deviens grincheux, depuis Port-Vendres. Je ne sais pas si c’est que la Méditerranée a marqué pour moi le milieu (le mitan, dirait un écrivain véritable, plus raffiné que moi, en plissant les yeux pour savourer le mot) du parcours, ce moment où l’on est loin du début et loin de la fin, où l’on flanche ; ou que l’océan, la mer, quotidiennement, trop de mer, finit par mouiller l’esprit, amollir, affaiblir – un mal de mer de l’âme ; ou que la mentalité trop décontractée, indolente des gens du Sud ne me convient pas (je suis…
Antoine Lilti, L’invention de la célébrité : 1750-1850, Paris : Pluriel, 2022, 442 p. Le livre retrace la naissance de la célébrité dans son acception moderne dans l’Europe des Lumières. La célébrité, telle qu’on la connaît aujourd’hui, trouve son essor à la conjonction de plusieurs développements sociaux, culturels et techniques : l’essor de la presse imprimée, la reproduction des images qui permet à des figures d’être connues et reconnues par le plus grand nombre, le développement des nouvelles techniques publicitaires et la commercialisation des loisirs. Le livre passe en revue les différentes figures de la célébrité qui ont émergé entre 1750 et 1850 : écrivains (Voltaire, Byron), figures politiques (Mirabeau, Napoléon, Garibaldi ou George Washington), comédiens et artistes (Liszt, Talma, la comédienne britannique Sarah Siddons). L’auteur s’attarde plus particulièrement sur le cas de Jean-Jacques Rousseau, sorte de figure paradigmatique de toutes les dimensions de la célébrité. Rousseau donne à voir une célébrité autant recherchée que rejetée, notion ambivalente qui fait de la reconnaissance publique un poids et donne aux personnes devenus célèbres l’impression de ne plus s’appartenir. Antoine Lilti traite également de la célébrité politique, avec l’apparition du concept de popularité qui devient une composante essentielle du jeu démocratique.